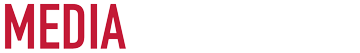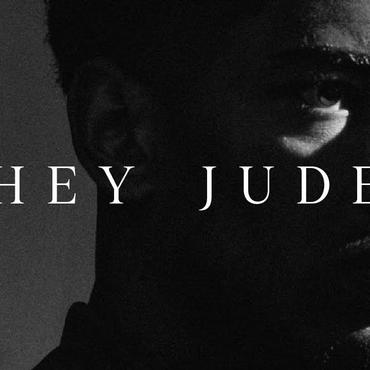Le photojournaliste est un individu qualifié, qui combine les compétences de la photographie et du journalisme. Il est donc un acteur-clé dans la transmission de l'information et dans la narration visuelle de l'actualité. Depuis le début des années 2000, les photojournalistes traversent dans la plupart des pays, une période de crise et d’instabilité expliquée par une concurrence féroce et peu contrôlable des banques d’images et des amateurs.
Au Maroc, cette situation est exacerbée par la faiblesse structurelle de ce groupe professionnel, l’influence des champs politique et économique dans le secteur de la presse ainsi que la fragilité du marché local. Une refonte du modèle économique a engendré l’abandon de la prise en charge de la fabrication d’image et l’altération des conditions de travail des photojournalistes. Dans cet article, nous tenterons de déchiffrer la situation des photojournalistes exerçant au Maroc ainsi que les déterminants de leur organisation en groupe professionnel différencié.
L’histoire de la presse marocaine est fortement influencée par la politique du pays. Si la fin du dix-neuvième siècle a été marquée par une presse fortement pro-coloniale ne s’adressant quasi-exclusivement qu’aux investisseurs étrangers au Maroc, elle fut progressivement concurrencée par des supports nationalistes, véritables porte-paroles des grands partis de l’époque. Après l’indépendance, la presse partisane s’est imposée : chaque grande mouvance avait ses organes de presse arabophone et francophone et les journalistes y étaient tous membres du parti. Les années de plomb ont constitué un tournant majeur, d’abord du fait de l’avènement de la presse dite « officielle », du détournement du lectorat vers la presse du Moyen Orient (moins politisée et plus généraliste) et du processus d’arabisation du pays qui marqua le début du tropisme du lectorat pour une presse arabophone. Les années 2000 sont marquées par les débuts d’une presse privée dite « indépendante » qui aborde des sujets politiques, sociaux et religieux. L’ouverture vers la presse en ligne s’est faite à la même période, mais ce n’est qu’à partir de 2011 que celle-ci arriva à s’imposer comme principale source d’information des Marocains. Rappelons qu’en 2016, le Maroc comptait 500 sites électroniques d’information et 243 titres de presse écrite (contre 537 en 2013).
Actuellement, les photojournalistes marocains, majoritairement masculins et souvent moins bien rémunérés que leurs collègues rédacteurs, font face à un double défi : l'absence d'une représentation syndicale dédiée et une reconnaissance professionnelle insuffisante. Cette situation n'est pas unique au Maroc mais se retrouve également dans d'autres régions du monde, où l'âge moyen relativement élevé des photojournalistes active les alarmes d'un secteur en manque de vitalité et de renouveau.
Par ailleurs, le photojournalisme est confronté à des défis éthiques et déontologiques majeurs, aggravés par l'exclusion des travailleurs indépendants du cadre professionnel établi et par le flou entourant les pratiques acceptables dans un monde médiatique en rapide évolution. L'émergence de la presse en ligne et la prolifération des nouveaux médias numériques ont introduit une couche supplémentaire d'incertitude, menaçant la spécialisation et la viabilité à long terme de la profession.
La sociologie des groupes professionnels offre une perspective enrichissante sur ces problématiques, mettant en lumière la nécessité cruciale pour les photojournalistes de revendiquer une reconnaissance officielle, de s'organiser et de se structurer de manière cohérente. La passion pour la capture d'images, plus que pour le journalisme en soi, guide fréquemment ces individus vers leur vocation. Néanmoins, cette passion se heurte souvent à un environnement qui valorise insuffisamment les parcours atypiques et l'importance de la formation formelle.
L'avènement du numérique a bouleversé le paysage photographique, ouvrant de nouvelles avenues tout en posant de sérieux défis. L'accès facile et la disponibilité accrue des images ont conduit à une dévaluation du métier de photojournaliste, incitant à une introspection sur les stratégies de différenciation et d'indépendance nécessaires pour naviguer dans cette nouvelle réalité.
Face à ces obstacles, les photojournalistes, que ce soit au Maroc ou ailleurs, doivent trouver un équilibre entre la mise en valeur de leur art et l'adaptation à un environnement médiatique en constante évolution. La quête pour une structure professionnelle plus solide, une reconnaissance plus large et une adaptation efficace aux exigences du numérique est plus pertinente que jamais.
En conclusion, ce résumé de recherche met en lumière plusieurs aspects critiques concernant le photojournalisme au Maroc. Premièrement, il souligne la fragilité du secteur de la presse, exacerbée par des décennies de censure politique et de contrôle financier, contribuant à la précarité des travailleurs, y compris des photojournalistes. Deuxièmement, il pointe le manque d'organisation professionnelle, l'absence de spécialisation, et le défaut de réglementation spécifique au Maroc, contrairement à d'autres pays où la profession est mieux structurée. Le cheminement vers la profession s'avère majoritairement autodidacte, sans un cadre formel de formation ou d'apprentissage, entraînant une déprofessionnalisation notable à l'ère numérique. La menace principale pour le métier ne vient pas tant des avancées technologiques que de la perte d'autonomie professionnelle. Le texte suggère que le numérique, tout en posant des défis, offre également l'opportunité d'institutionnaliser et de formaliser le secteur. Enfin, il appelle à une étude plus approfondie des aspects sociologiques et économiques de la profession pour mieux répondre aux besoins des photojournalistes.
Extrait du mémoire de recherche du Master M2 en « Communication des organisations », préparé en 2023 par M. Mehdi Meriouch, au sein de l’Ecole Supérieure de Communication et de Publicité Com’Sup, Groupe Edvantis.